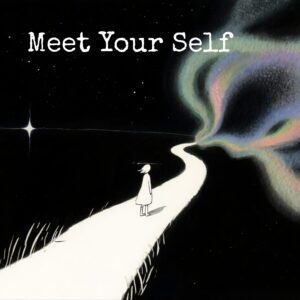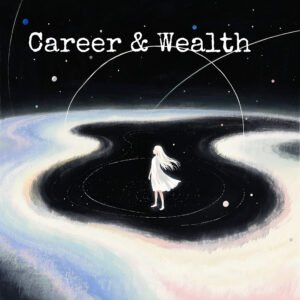La foi rencontre le cosmos
Dans le monde intellectuel du XIIIe siècle, peu de penseurs ont façonné la pensée occidentale aussi profondément que Thomas d'Aquin (1225–1274 CE).
Philosophe, théologien et frère dominicain, Thomas d'Aquin chercha à concilier la sagesse de Aristote avec les révélations de théologie chrétienne.
Ce faisant, il a donné à l'astrologie — alors une science florissante héritée des traditions grecque, arabe et scolastique — une place soigneusement raisonnée au sein de la philosophie chrétienne.
Bien qu'Aquinas n'ait pas pratiqué l'astrologie, il en comprenait la logique et l'influence. Ses écrits révèlent à la fois un profond respect pour l'ordre cosmique et une ferme défense de la liberté humaine, donnant naissance à la célèbre maxime :
« Les étoiles inclinent ; elles ne contraignent pas. »
Cette simple phrase allait définir l'attitude de l'Église envers l'astrologie pour les siècles à venir.
Le contexte médiéval : un monde d'harmonies
À l'époque où Thomas d'Aquin écrivait, l'astrologie avait déjà fait son entrée dans le monde. cursus universitaire.
Textes de Ptolémée, Abou Ma'shar (Albumasar), et Al-Kindi avait été traduit en latin, mêlant la philosophie naturelle aristotélicienne à la mécanique céleste.
L'astrologie était enseignée au même titre que la médecine et la géométrie, considérée comme faisant partie intégrante de la compréhension La création de Dieu par les causes naturelles.
Pour les scolastiques comme Thomas d'Aquin, l'univers n'était pas divisé entre esprit et matière — il était un hiérarchie de la causalitéLes sphères célestes transmettaient la volonté divine par un mouvement ordonné ; le monde sublunaire recevait et exprimait ces influences sous forme de phénomènes météorologiques, de tempérament et de temps.
La question à laquelle Thomas d'Aquin était confronté n'était pas de savoir si les cieux agissaient sur la terre — cela était clair pour tous les philosophes de la nature — mais jusqu'où leur influence s'étendait dans le choix humain et le salut.
La Somme théologique : Astrologie et causes naturelles
Dans son Somme théologique (Première partie, question 115), Thomas d'Aquin aborda directement la question : « Les corps célestes sont-ils la cause des actes humains ? »
Il a reconnu que les mouvements célestes influencent corps physiques— par exemple, les marées, la météo, et même l’équilibre des humeurs dans la constitution humaine.
Il a toutefois établi une distinction cruciale entre le corps, qui est soumise à la nature, et l'âme, qui possède la raison et le libre arbitre.
Selon Thomas d'Aquin :
Les étoiles peuvent affecter les dispositions corporelles, comme la santé ou le tempérament émotionnel.
Ils ne peuvent pas contraindre l'âme rationnelle, qui est guidée par l'intellect et la volonté.
L'astrologie peut donc révéler tendancesmais pas nécessités.
Dans cette synthèse, Thomas d'Aquin a préservé le l'intégrité scientifique de l'astrologie tout en préservant responsabilité morale.
Il n'a ni condamné l'art ni l'a accepté sans critique ; il l'a plutôt inscrit dans le cadre de divine providence—un cosmos régi par des lois et un ordre précis, auquel la liberté humaine participe encore.
Les étoiles comme instruments de la providence
Pour Thomas d'Aquin, les étoiles n'étaient pas des dieux ni des puissances indépendantes, comme le croyaient les païens. Elles étaient causes secondaires—instruments de la volonté première de Dieu.
Il a écrit :
« Les corps célestes sont mus par des substances spirituelles et agissent comme instruments de la volonté divine. »
L'astrologie faisait donc partie de théologie naturelle: l'étude de la manière dont la sagesse divine se manifeste dans le monde matériel.
Les étoiles révélaient l'harmonie de la création, mais ne pouvaient jamais prévaloir sur la grâce du Créateur.
Cette vision unifiait la foi et la science au sein d'une hiérarchie de significations unique :
Dieu — la Cause Première et la source ultime de l'ordre.
Anges et intelligences — moteurs des sphères.
Corps célestes — transmetteurs d'influences naturelles.
Les humains — êtres de raison, capables de connaître et de transcender la nature.
L'influence de l'astrologie arabe
La position nuancée de Thomas d'Aquin a été façonnée par les philosophes arabes dont les œuvres ont dominé les universités médiévales : Al-Kindi, Avicenne, et Abou Ma'shar.
D'eux, il a hérité de l'idée de causalité céleste agissant par la chaleur, la lumière et le mouvement – des forces naturelles plutôt que magiques.
Mais là où Al-Kindi et Abu Ma'shar considéraient l'astrologie comme une science rationnelle au sein de la chaîne des causes, Thomas d'Aquin y ajouta une correction théologique :
La nature fonctionne selon le principe de cause à effet.
Pourtant, la grâce opère au-delà de la nature.
Ainsi, l'astrologue pouvait lire les tendances du temps, mais l'âme restait libre dans ses choix moraux et spirituels.
Héritage et influence durable
La synthèse de Thomas d'Aquin devint la position philosophique officielle de l'Église catholique.
Elle autorisait l'étude de l'astrologie dans le cadre de la philosophie naturelle, à condition qu'elle ne prétende pas exercer un pouvoir sur l'âme ou la volonté divine.
Cette vision équilibrée a permis à l'astrologie de rester intellectuellement vivante à travers les siècles. Renaissance, où des penseurs comme Marsile Ficin et Giovanni Pico della Mirandola on a débattu de sa signification morale et spirituelle.
Chez Ficin Trois livres sur la vie, les échos de Thomas d'Aquin sont clairs : les cieux influencent notre tempérament et notre vitalité, mais la sagesse nous permet de coopérer consciemment avec les astres, et non de nous y soumettre.
Le théologien de la liberté cosmique
Thomas d'Aquin a donné à l'astrologie son centre moral.
Il a rappelé aux théologiens comme aux astrologues que la connaissance des cieux n'est pas une fin en soi, mais un moyen de comprendre l'ordre de la création.
Dans sa vision, les étoiles expriment la raison divine, mais l'âme humaine reflète la liberté divine.
Dans cet équilibre – entre loi et grâce, cause et choix – Thomas d’Aquin a offert une vision du cosmos qui reste profonde aujourd’hui :
un univers où destin et conscience coexistent,
et là où l'étude des cieux est un acte de révérence, et non de rébellion.